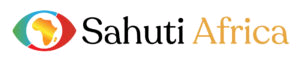Sous une pluie battante, des silhouettes dorment allongées parmi les décombres de leurs anciennes maisons. Gift, elle, est assise sur un bloc de béton, là où se trouvait sa porte d’entrée.
Avertie en urgence par des voisins, cette vendeuse de bananes plantains se rappelle avoir accouru, trop tard. La démolition du bidonville avait déjà commencé. Sa vie, ses souvenirs « détruits ». « J’ai tout perdu », se lamente-t-elle.
Près des eaux polluées de Port Harcourt, principale ville pétrolière du Nigeria située dans le sud, les quartiers informels faits de matériaux de récupération abritent un demi-million de personnes.
Autant d’âmes menacées d’être expulsées de force, sans alternative ni compensation : début janvier, le gouverneur de l’Etat de Rivers, Ezenwo Nyesom Wike, a annoncé la démolition de tous ces habitats informels sur le front de mer, devenus, selon lui, des « repaires de criminels ».
Dans la foulée, les démolitions ont commencé fin janvier.
Le quartier informel de Diobu par exemple, dans le sud-ouest de la ville, a été à moitié détruit. En l’espace de six jours, près de 20.000 résidents ont perdu leur logement et leur moyen de subsistance.
Car grâce à la pêche, aux marchés ambulants et au transport maritime, la plupart dépendent du littoral pour survivre.
Beaucoup vivaient là depuis des décennies. Leurs aïeux avaient tout construit de leurs mains. Aujourd’hui, il ne reste plus que 11 hectares de décombres.
Démographie galopante
« On vivait paisiblement ici », se lamente Tamunoemi Cottrail, propriétaire local et vendeur de poissons, avant de se remémorer l’arrivée des hommes armés.
« Ils n’ont parlé à personne. Ils ont juste dévalé les marches et commencé à tracer des X sur certains bâtiments ».
Les autorités locales n’ont pas donné de détails sur l’avenir du front de mer, une fois les bidonvilles détruits. Mais elles assurent que les démolitions des communautés informelles sont nécessaires et légales.
« La loi autorise (les démolitions) tant que c’est pour l’intérêt public », indique un membre de l’Autorité de développement du logement et de la propriété de l’État de Rivers, sous couvert d’anonymat.
Ces expulsions forcées illustrent avant tout le développement urbain complexe des villes du pays le plus peuplé d’Afrique (220 millions d’habitants) qui, selon les estimations de l’ONU, deviendra le troisième plus peuplé du monde d’ici 2050.
Avec cette démographie galopante et une planification urbaine ignorée, des millions de Nigérians continueront de s’agglutiner dans des bidonvilles, aux conditions de vie très difficiles.
A Port Harcourt, capitale de l’or noir au Nigeria, premier producteur de brut d’Afrique, un tiers des habitants vivent dans ces quartiers.
Ces communautés subissent les premières les dégâts environnementaux de l’extraction du pétrole et du gaz.
« Les gens ne s’installent pas délibérément dans des habitats informels », rappelle Isa Sanusi, le porte-parole d’Amnesty International au Nigeria.
« Il ne devrait pas y en avoir dans ce type d’endroit, car les Etats sont riches et ont la capacité de subvenir aux besoins ».
Coups de fouets et mensonge
A Diobu, les autorités locales ont affirmé aux résidents qu’ils avaient sept jours pour faire leur sac.
« Quand ils sont arrivés, ils ont commencé à fouetter les gens », souffle Omobotare Abona, pêcheur de Diobu. « Quand les gens disaient : +Attendez, laissez-nous rassembler nos affaires parce que c’est soudain+, ils répondaient : +Sortez+ ».
Les démolitions ont commencé trois semaines après l’annonce du gouverneur Wike dans son discours du Nouvel An. Il y fustigeait ces habitats informels qui « servent de repaires et de planques aux criminels », notamment -selon lui – aux voleurs qui siphonnent les pipelines de pétrole.
« C’est un mensonge », lance M. Abona. Comme partout, il y a des « mauvaises personnes », mais il ne faut pas généraliser, assure-t-il.
Face au mécontentement des populations locales, le commissaire régional à l’Information Paulinus Nsirim a adopté un ton plus sévère, insistant sur le besoin « d’assainir les fronts de mer ».
Beaucoup d’anciens résidents de Diobu ont emménagé ailleurs chez des proches. Certains sont restés près du littoral, faute d’alternative, leurs meubles et vêtements empilés sur les trottoirs.
Les communautés alimentent une économie informelle vitale pour la ville, qui représente jusqu’à 65% de l’activité économique réelle.
Pourtant, elles vivent dans une extrême pauvreté, sans service public et sans représentation politique.
M. Abona a envoyé sa femme et son fils de 6 mois chez un parent, mais ne s’imagine pas vivre ailleurs. « J’ai grandi ici, je m’y sens en sécurité », insiste-t-il. Ce pêcheur revient souvent sur le site où sa maison a été démolie. Il dit attendre le bon moment pour reconstruire.
AFP/Sahutiafrica