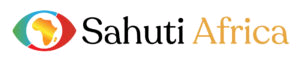On n’écrira jamais assez sur la crise sanitaire qu’a apportée la COVID 19. On dira combien des milliards d’individus étaient confinés à travers la planète. On relatera à quel point les économies tournaient au ralenti et enregistraient de grands reculs. On dira aussi que sans le vouloir, la pandémie avait soufflé sur les cendres d’un humanisme mourant et ravivé les braises presqu’éteintes de la solidarité. Mais on précisera que cette solidarité renaissante était l’apanage des pays qui engageaient des moyens colossaux, quitte à s’endetter à hauteur des milliards de dollars pour la riposte sanitaire et la relance économique.
Dans ces pays où les lois du marché n’avaient pas fini de déconstruire les réflexes d’intervention des États, les gouvernements ont su rebondir sur leurs moyens logistiques, sur leurs atouts financiers, et sur leurs capacités d’emprunter, pour mitiger un tant soit peu les effets de la pandémie. C’est dans ces élans de solidarité nationale que des états se sont livrés une guerre surréaliste d’approvisionnement en masques (y compris sur les tarmacs d’aéroports), que des chèques sont distribués aux ménages pour relancer la consommation, et que des vaccins commencent à être administrés.
L’Afrique en observateur?
L’Afrique quant à elle est restée très en retrait de ces dynamiques de sursaut, demeurant largement confinée dans la faillite des États et subissant l’absence des structures sanitaires adéquates. Depuis les indépendances, cette Afrique a pourtant eu 60 ans. Un âge qui lui aurait permis de financer des politiques publiques d’éducation, de santé, et de recherche. Et elle n’en a rien fait. Et voilà que, de la bataille pour les masques à la priorisation des siens pour les vaccins, l’Occident, pourtant “secoureur” traditionnel des africains, indique, et pas sans une certaine raison, que l’Afrique ne devrait pas compter sur elle. En effet, plusieurs mois s’écouleront avant que des campagnes de vaccination de masse n’aient lieu en Afrique, alors que la riposte sur le front économique tarde à s’organiser.
En dépit du “miracle” observé dans la faible pénétration du virus en Afrique, le délitement des secteurs de la santé, l’anémie des économies, l’arriération des systèmes éducatifs et la faillite des États tracent très clairement la ligne de démarcation entre l’Afrique et le reste du monde. Aucune autre partie du globe ne concentre pareilles insuffisances. Ailleurs, Cuba, pourtant longtemps sous embargo américain, a mis au point son propre vaccin. D’autres pays d’Amérique du Sud, loin d’être particulièrement développés, passent des grosses commandes de vaccins.
Appel à la solidarité pour l’Afrique
En définitive, la crise sanitaire mondiale a questionné la civilisation humaine de fond en comble. Elle a mis le doigt sur l’abcès des questions ignorées, notamment l’édification d’un système de santé digne de ce nom et l’investissement dans la recherche. Très vite, les leçons qui sont tirées de ce sombre chapitre se reflètent dans des nouvelles orientations économiques et sanitaires, et invitent une réinvention du monde. Les pays d’Afrique ont ici à la fois l’opportunité et l’obligation de se doter des structures étatiques solides, d’allouer les moyens nécessaire à l’éducation, à la santé et à la recherche, pour améliorer la qualité de vie et se prémunir des maux qui pourraient advenir. En un mot, les africains doivent combler leur déficit de gouvernance.
Siméon Nkola Matamba