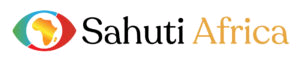Peignant un bâtiment à Dakar, la capitale en pleine mutation du Sénégal, Ismaila Ba est l’un des nombreux travailleurs à se sentir exclus de la transformation de ce pays d’Afrique de l’Ouest sous le président Macky Sall.
« Je gagne 6 000 francs CFA par jour (environ 10 dollars) », explique Ba, qui paie 80 000 francs par mois pour deux chambres pour lui, sa femme et ses deux filles dans le quartier populaire de Ouakam.
« Comment pourrais-je rêver d’avoir un appartement dans cet immeuble ? », Sall a changé le visage du Sénégal à travers de grands projets publics et privés sur 12 ans. En plus de créer la nouvelle ville de Diamniadio, près de Dakar, il met en place une liaison ferroviaire rapide entre Dakar et sa banlieue. Les salaires ont également augmenté et des aides aux pauvres ont été distribuées sous Sall.
Mais le peintre en bâtiment Ba, qui travaille également comme coiffeur et vend du café pour joindre les deux bouts, estime que cette croissance profite à une minorité dont le niveau de vie contraste avec celui de la majorité.
Aujourd’hui, au moins un tiers des 18 millions d’habitants du Sénégal vit encore dans la pauvreté, selon l’Agence nationale des statistiques (ANSD). La proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté n’a diminué que de cinq pour cent entre 2011 et 2018-2019.
Un héritage mitigé
Au cours des trois dernières années, le gouvernement a tenté de contenir les crises successives, notamment les troubles qui ont fait des dizaines de morts et des centaines d’arrestations, malgré la réputation du Sénégal comme l’un des pays les plus pacifiques de la région.
Sall devrait quitter ses fonctions de président lors des élections du 24 mars, mais seulement après que son report de dernière minute du vote le mois dernier ait provoqué l’une des pires crises depuis des décennies.
Un bilan économique qui permet à Sall de « entrer dans l’histoire du Sénégal » est entaché par cette » sortie bâclée », a déclaré le philosophe Souleymane Bachir Diagne sur Radio France Internationale.
Il a qualifié d’« inexplicable » la tentative de Sall de reporter l’élection présidentielle – une décision rapidement annulée par le Conseil constitutionnel.
L’écrivain et universitaire Felwine Sarr, interrogé dans l’hebdomadaire Jeune Afrique, abonde dans ce sens et ajoute : « Sous sa direction, diverses méthodes de fermeture de l’espace public et d’entrave à l’exercice des libertés sont malheureusement devenues familières ».
Ce point de vue a trouvé un écho dans les rues ces dernières semaines, alors que certains manifestants scandaient : « Macky Sall, dictateur ». Mais Sall a insisté : « Le Sénégal est un véritable Etat de droit. J’ai refusé de me laisser tenter par un troisième mandat. Je suis démocrate ».
Et en réponse aux critiques, lui et ses partisans ont souligné son bilan en matière de reconstruction des infrastructures du pays. « Le pays dont j’ai hérité était vraiment délabré », a récemment déclaré Sall.
En attendant le pétrole
Outre les troubles politiques, Sall a conduit le Sénégal à surmonter des défis économiques tels que la pandémie de Covid-19 ainsi que les restrictions sur les importations de céréales ukrainiennes et de riz indien. Ces crises ont mis un frein à la croissance soutenue du Sénégal, même si elle reprend.
Le produit intérieur brut (PIB) devrait désormais atteindre un niveau sans précédent de 9,2 % en 2024, tiré par le développement pétrolier et gazier, selon les statistiques gouvernementales.
Mais les chiffres du gouvernement montrent également que les dépenses publiques destinées à contrer les crises, à protéger les plus vulnérables et à stimuler l’économie ont fait passer la dette de 40 % du PIB en 2012 à 69,4 % fin 2023.
L’économiste Moubarack Lo reconnaît que la transformation du pays a « créé un terrain fertile pour l’endettement », mais il estime que cela était nécessaire pour développer les infrastructures qui « ont changé le visage de Dakar ». D’autres, cependant, soutiennent que cet investissement s’est fait au détriment des conditions de vie.
« Macky Sall a choisi d’investir dans les infrastructures et a oublié la qualité de vie », a déclaré l’économiste Cheikh Bamba Diagne. Le chômage est passé de 10,2 pour cent en 2012 à environ 20 pour cent en 2024, selon l’ANSD.
« Il n’y a pas de travail dans le pays », a déclaré le mécanicien Makhmadane Diouf, 38 ans, malgré les riches gisements miniers du Sénégal. C’est l’une des raisons pour lesquelles des dizaines de milliers de jeunes Sénégalais ont choisi de tenter le dangereux voyage à bord de petits bateaux pour rejoindre l’Europe à la recherche d’une vie meilleure.
AFP/Sahutiafrica